Que n’a-t-on pas écrit sur le toquat !
Bien des auteurs n’ont-ils pas chanté sa grâce et sa
légèreté ? Tous les dictionnaires et les almanachs n’en ont-ils pas donné
des « reproductions » ? La publicité même, n’en propage-t-elle
pas le nom et l’allure aux quatre coins de France ?
Il apparait donc que les documents ne manquent point, qui
permettent d’étudier les formes diverses de cette coiffe splendide, les lieux
dont elle est originaire, et aussi son évolution.
Il semble difficile que tous ces toquats qui nous sont
offerts par gravures ou photographies, ne soient pas authentiques ou, du moins,
ne s’inspirent pas des documents les plus sérieux.
Quels sont donc ces documents ?
Les Aubois ne connaissent guère qu’un seul exemplaire de
toquat dont l’origine est absolument certaine : celui qui est exposé au
musée de Vauluisant. Ils n’ignorent pas les dessins de Fichot, ceux d’Arnaud,
ainsi que le tableau de Valton, récemment acquis par les amis des Musées.
Quelles sont alors les autres sources auxquelles ont pu se
référer les auteurs ? N’aurait-on pas quelque peu brodé sur la
question ?
C’est pourquoi nous avons demandé à Gilbert Roy de nous
parler du toquat. De celui du musée de Troyes d’abord, qu’il a rénové, dont il
a extrait, il y a un an à peine quelque deux cent cinquante épingles qui le
maintenaient en son éclat d’origine, qu’il a entièrement démonté, et dont il a
ravivé l’éclat, pour finalement le rajuster en sa splendeur première.
Il nous dira ensuite ce qu’il pense des autres toquats, qu’il
a aussi longuement étudiés. Ceci nous
aidera à voir plus clair dans tout ce qu’on nous propose aujourd’hui.
Il nous sera possible alors de cerner l’histoire véritable
de cette coiffe essentiellement
troyenne, de la démystifier au besoin et surtout, de la réhabiliter.
Ce sera une manière de la défendre que de n’accepter, pour
son honneur et sa gloire, rien qui ne soit authentique, mais tout ce qui l’est.
Voilà le pourquoi de
numéro huit de notre Revue, un numéro exceptionnel que nos lecteurs ne
manqueront pas d’apprécier.
Le
Toquat coquille journalier
Le toquat ne serait qu’une grande coiffe de cérémonie. Cette
légende a été soigneusement entretenue. Elle est encore répandue par ceux qui
ne voient dans le folklore qu’un aspect strictement spectaculaire.
En fait, il n’en est rien ; c’est une coiffe de type
« à câle » qui a de nombreux points communs avec les autres bonnets
de notre région.
Le toquat dit « coquille » se portait tous les
jours de la semaine, à la manière de la capeline, avec cette seule différence
que la coiffe légère en voile se posait sur la câle matelassée, alors que la
capeline en toile durcie, se portait par-dessus la coiffe fine.
Ce toquat journalier se rencontre fréquemment sur les
dessins de Ciceri, principalement sur les gravures de faubourg Saint-Jacques.
Cette fréquence en un pont déterminé s’explique par le fait
que cette coiffe était principalement connue à Saint Parre aux Tertres.
On retrouve également ce même type à Brienne le château.
Toutefois, dans cette ville nous n’avons jamais eu connaissance qu’il ait été
porté « dressé », ce qui exclurait donc la dénomination de
« toquat » qui s’attache, non à la coiffe elle-même, mais à une
manière de la porter.
Schéma de la coiffe
- la câle est un béguin en toile matelassée, nouée sous le
cou ; elle emprisonne la chevelure et soutient la coiffe.
- la coiffe est en voile ou tulle brodé ou uni suivant la
fortune de sa propriétaire ; elle comporte un fond « rond », ample dont les coulisses
se nouent au-dessus de la câle.
- la passe très ample, fortement frondée et sillé sur le
fond, peut-être simple ou double, selon la richesse de celle qui porte la
coiffe ; les fronces sont soutenues aux tiers par un cordonnet passé au
point devant.
Le
toquat de la région de Saint-Parre-au-Tertre – Montaulin
A partir de la coiffe des jours de semaine, et sans rien y
changer, on forme le toquat simple, en coquille. Sur une câle plus dure, en
toile gommée, on dispose la coiffe de voile, on serre les coulisses, on les
noue sur la câle en les retenant par des épingles puis, toujours à l’aide
d’épingles, on tend le fond en le ramenant, par devant, sur la frontière.
On place ensuite une bande de tissu de la largeur de cette
frontière (velours ou reps), de couleur vive (bleu, noir, rouge, violet) ;
on l’épingle dessus, puis on rabat en arrière la passe de voile en ramenant les
fronces pour former un éventail (coquille) ; on épingle à nouveau puis on
cisaille » (1) cet éventail pour lui donner de la tenue, après amidonnage
bien entendu.
Sur le sommet de la câle et derrière la coquille, on coud un
« faux nœud » de faille ou de reps (noir, bleu ou violet), à deux
boucles et deux brins, qui cache une armature en « fil modiste » et
qui sert de soutien à l’ensemble.
Lorsque cet assemblage est réalisé, on dispose sur la
frontière (2) un revers de dentelle plissé et, bien sûr, épinglé.
Les coiffes riches se portaient sur une câle au fond brodé
de motifs bleus (à la manière normande). On a longtemps laissé croire que ces motifs étaient l’image d’un sapin, ce qui
est absolument faux.
D’ailleurs, on
attribuait à cet arbre, dans nos régions, un symbolisme tel, que peu de filles
auraient osé le présenter en public.
(1)Cisailler : plisser très finement à l’aide d’un fer
spécial dit « cisaille » ou « fer à tuyauter ».
(2)Frontière : c’est la partie située en avant du fond,
et qui couvre le dessus de la tête. Cette frontière est en matériaux
relativement fermes, tels que : toile durcie, gommée, matelassée, etc.
Passe : c’est
cette même partie de la coiffe mais, cette fois, en matériaux légers :
voile, tulle, dentelle.
Le
toquat coquille dans la région de Saint-Parre-au-Tertre – Montaulin
La seule gravure de la « Fleuriotte » que nous
possédons, représente Louis Fleuriot arborant un toquat coquille.
Native de Daudes, puis ayant habité Lusigny et enfin placée
à Clérey, il parait étrange qu’elle ne porte plus la coiffe de son pays d’élection :
Lusigny. Le fait est d’autant plus troublant que les contemporains qui l’ont
dépeinte notent bien qu’en semaine, les barbes de sa coiffe voltigeaient sur
ses épaules.
Il y a donc là une contradiction formelle, et nous sommes
prêts à croire que le dessinateur a reproduit le toquat de la région de
Saint-Parre-au-Tertre-Montaulin, région où Louis Fleuriot a travaillé.
Cette coiffe se différencie de celle faisant l’objet de la
description précédente, par quelques points de détails.
Elle est d’abord plus importante, plus richement ouvragée.
La base de l’éventail est garnie d’un rucher de dentelle double. Par contre,
les rubans sont absents, mais l’éventail est soutenu par deux arceaux de fil
modiste cousus dans le voile. (Nous avons également trouvé une coiffe
comportant des « baleines », rayonnantes mais, comme ce procédé n’a
pas été confirmé, nous préférons constater, sans faire d’hypothèse).
Ce type de toquat a été présenté par Valton dans plusieurs
de ses dessins ; Fichot l’a repris, ainsi que Ciceri.
Le
toquat à Barbes
C’est le type le plus connu et aussi le plus
« galvaudé » par ceux qui croient savoir.
En semaine, cette coiffe, nettement plus riche, se
portait barbes tombant sur les côtés ou
plus fréquemment semble-t-il, épinglé par derrière.
Ce port de toquat a laissé croire, (pour quel mystérieux
motif ?), que les Champenoises abaissaient leur coiffe pour se rendre à
l’église. L’histoire serait belle si elle était vraie. Il suffit de savoir par
quel assemblage de fil de fer et d’épingles l’échafaudage était maintenu, pour
comprendre l’invraisemblance d’un tel conte.
La coiffe de ce toquat est de type « à barbes »,
comme on en rencontre dans de nombreux pays de l’Aube, toutefois, elle s’en
différencie par le fait que les dites barbes sont, pour ce toquat, pliées en
deux par le devant au lieu d’être double à partir du fond ; leur lisière
extérieure est garnie d’un rang de dentelle tuyautée.
Le petit éventail est soutenu par deux coques de ruban
armées ; formant un nœud placé en arrière et composé de deux bouts et
quatre boucles.
Un petit secret de montage consiste à ramener les barbes à
l’arrière sans qu’il y ait « surépaisseur », tout en conservant le
tuyautage par derrière. C’est une sorte de pliage accordéon, un tour de main
difficilement traduisible, mais que nous essaierons de reproduire en croquis
sur la fiche du patron.
Valton a reproduit ce type de coiffe sur plusieurs de ses
tableaux. Il l’a toujours fait porter par des personnes âgées ; serait-ce
parce qu’elles s’accommodaient mieux que les jeunes, de sa simplicité
rustique ?
Le
Toquat de Lusigny
Un très bel exemple de
ce toquat, que nous avons restauré il y a un an, est exposé au musée de
Vauluisant à Troyes, dans une vitrine de la salle de Folklore.
C’est un type parfaitement authentifié, puisque nous savons
qu’il fut porté à Lusigny par jeanne Camuset lors de son mariage avec jacques
Pinguet, en 1829.
La câle est identique à celles précédemment décrites.
La coiffe est du type à barbes, très amples, finement
froncées et brodées d’une large dentelle de tulle brodé.
Le revers de dentelle ne couvre que la moitié de la passe,
laissant ainsi mieux paraitre les coques de ruban inclus entre la coiffe et la
câle.
Sous le rucher, au pied de l’éventail, se place une seconde
bande de ruban, large de 10mm environ, épinglée et cachant la base des
armatures de fil modiste.
Les coques de ruban, armées également, sont prises entre
l’éventail et le retour des barbes.
La double armature de fer est prisonnière entre les deux
épaisseurs de barbes et se croise derrière les coques.
Le montage demande également qu’on connasse le petit
« secret » qui permet de ramener les barbes à l’arrière puis de les
retourner pour que la dentelle apparaisse à l’extérieur. A noter que les barbes
recouvrent toute la partie arrière de la câle sur laquelle elles sont tendues
et épinglées.
Un second nœud à deux boucles et deux pans, sans armature,
relie ensemble les deux bords des barbes et cache l’épinglage.
Le
Toquat de Troyes
Bien que, dans leurs dessins, les graveurs comme Arnaud, Valton,
Fichot, Ceceri aient reproduit devant les monuments troyens, tous les types de
différents toquats que nous avons étudiés, il est une coiffe particulière qui
ne se trouve en abondance que sur les gravures de Troyes.
Ce toquat est de même conception que celui donné pour Lusigny,
mais il est plus ample et surtout plus haut.
D’autre part, les barbes sont dissymétriques, lorsqu’elles
sont remontées et assemblées, la partie avant étant plus arrondie que la partie
arrière, cela a pour effet de former une sort d’arc gothique au-dessus de
l’éventail.
Les dimensions un peu grandes de cette coiffe se trouvent
compensées par la finesse du matériau employé ; c’est un tulle léger,
fortement empesé et froncé, soutenu par la double armature de fil de fer.
Les rubans en ottoman ou reps sont également plus longs,
donnant ainsi une meilleure tenue à l’ensemble.
Expansion
géographique du toquat
Pourquoi ?
Par manque d’informations, et bien souvent par simple
paresse, il a été admis que le toquat était porté dans l’Aube, la Marne, la
Haute-Marne, disons… dans toute la province.
Pour notre seul département, on nous a proposé des toquats
de Vaudes, de Bar-sur-Aube, de Romilly, de Colombé-la-Fosse, de
Rumilly-lès-Vaudes, pour ne citer que les plus marquants.
Nous devons avouer que nous-même, avons été d’abord abusé
par cette profusion et pas les arguments « remarquables » qui
tendaient à les authentifier.
C’est grâce à de nombreuses enquêtes « in-situ »
menées avec la collaboration de chercheurs objectifs qu’il a été possible de
déterminer précisément les régions dans lesquelles on a effectivement porté le
toquat au siècle dernier.
Comment ?
Comment ont été menées ces recherches ? Simplement en
raisonnant, par éliminations progressives. La plus grande partie des villages
de l’Aube nous ont fourni, soit par de photographies (notamment de mariage), soit
par des gravures, la forme générale de leur coiffe ; très fréquemment
aussi, nous avons pu nous procurer des bonnets authentiques. Ce système a
montré par ailleurs, qu’il y avait bien, comme nous l’avions déjà suggérés, des
régions géographiques où prédomine une forme de coiffe, et également un type de
bonnet dit « de jour » qui se retrouvait dans l’ensemble du
département, et aussi, dans chacune de ces régions, un ou deux pays qui se
singularisaient par le port d’une coiffe très particulière.
Procédant ainsi, nous sommes arrivés à délimiter un triangle
dont les sommets sont Troyes, Rumilly-lès-Vaudes, Lusigny-sur-Barse.
Méthodiquement, chacun des villages compris dans ce secteur
a été examiné. Egalement, nous avons repris la documentation qui y est
relative : gravures, textes d’auteurs anciens, photographies, etc.
Où ?
De ce tri systématique sont sortis 5 villes ou
villages : Clérey, Montaulin, Lusigny-sur-Barse, Saint-Parre-au-Tertre,
Troyes et peut-être (mais les recherches n’ont pas encore apporté de preuves
formelles), Verrières et Rouilly-Saint-Loup.
Nous sommes donc en mesure aujourd’hui d’affirmer que,
seulement dans sept villes ou villages, on a pu porter le toquat et qu’en toute
certitude, il n’a jamais été porté ailleurs dans notre département.
Certes, nul système n’est parfait. Il se peut qu’un défaut
un oubli, se soient glissés dans notre étude. Si tel était le cas, nous
n’hésiterions pas à le signaler en son temps, comme nous nous sommes toujours
efforcés de le faire.
Lesquels ?
Il est apparu que deux grands types de toquats étaient en
vogue dans cette région.
1° Le toquat dit « coquille » qui se portait les
jours ouvrables, rabattu sur le visage ; les dimanches et jours et fêtes,
on relevait ce toquat en manière d’éventail, et, pour les grandes cérémonies,
les Champenoises, possédaient une coiffe plus richement brodée, plus ample
également, qui donnait l’image d’une coquille Saint-Jacques, proche parente du
« soleil » de Boulogne.
2° Le toquat dit « à barbes » ; celui-ci
semble avoir toujours conservé sa petite auréole sur le dessus, même pour les
jours ouvrables. Par contre, on laissait flotter les longues barbes soit dans
le dos, soit sur les épaules ; là aussi la Champenoise disposait d’une
coiffe plus richement ornée pour les grandes cérémonies ; pour les fêtes,
on relevait les longues barbes et on les dressait sur une armature de fil de
fer ; dans tous les cas, le montage s’effectuait à l’aide de multiples
épingles : environ 200 à 300 étaient nécessaires pour les pièces les plus
ouvragées.
Ainsi nos aïeules pouvait-elles se dire, selon le
diction : « tirées à quatre épingles ».
Cette coiffe est devenue le symbole de notre province. Il
n’en faut pour preuve que les multiples représentations que l’on rencontre soit
dans les manifestations locales, soit sur des marques ou des labels commerciaux.
A juste titre nous pouvons être fiers de cette publicité car le toquat est
considéré comme l’une des « belles coiffes de France » et il serait
regrettable qu’il soit oublié.
Les
Toquats Publicitaires
Malheureusement, cette multitude de reproductions a créé des
antécédents bien souvent fâcheux. Les peintres, les graveurs, les maquettistes
de notre siècle ont vu le toquat en fonction des besoins de leur création. Ceci
les a conduit tout naturellement à interpréter et non à reproduire fidèlement ;
or ces évocations ont fréquemment été prise au « pied de la
lettre » pour faire des reconstitutions. Il va sans dire que, si l’œuvre
d’un artiste moderne est compréhensible dans son contexte, la reconstitution
que l’on peut en tirer n’a aucun intérêt. Pourtant, ce mode de compilation nous
a valu et nous vaut encore bien des « bonnets de bazar » donnés pour
vrais.
Et ceux
pour « Faire Folklore »
A cette liste de coiffes nées des « cartons », il
faut ajouter les toquats qui furent créés de toutes pièces, par pure fantaisie
et en toute connaissance de cause, pour « faire folklorique ». Cette
fraude, si elle abuse les étrangers n’amuse nullement nos anciens. Elle les
gènes et ils n’hésitent pas à la combattre. Au cours de leur enquête, nos amis, nos
collaborateurs, ont fréquemment reçu des réponses ironiques concernant ces
coiffes ; sans citer les auteurs nous nous borneront à retranscrire ces
deux conversations :
« Madame avez-vous connu le toquat ?
- Le Beau Tocquat ? Oh oui, monsieur bien sûr… au
théâtre, monsieur, mais pas chez nous… »
« Monsieur le Maire, ces personnes portent des toquats,
comme autrefois au pays ?
- Elles s’habillent encore de « mensonges »...
c’est pas du vrai. »
Nous ajouterons les toquats qui ont été reconstitués – de
bonne foi – à partir de renseignements faux ou douteux, et enfin, ceux qui ont
été réellement portés au siècle dernier et qui sont, bien entendu les moins
nombreux.
Certes, notre province possède, avec les toquats, une richesse
de coiffes très remarquable, malheureusement, il y a eu tant de copies, que
nous nous trouvons devant un trésor de… faux-monnayeur.
Louise
Fleuriot dite Le Beau Toquat
Il est nécessaire, dans l’étude du toquat, de rouvrir le
dossier « Louise Fleuriot », ne serait-ce que pour détruire les
légendes de «La Fleuriotte », légendes qui n’ont aucun fondement
populaire.
Louise Fleuriot est née à Daudes le 8 janvier 1785. Son
père, Nicolas Fleuriot, est âgé de 25 ans. Sa mère, Sébastienne Denys a 33 ans.
Ils sont tous deux domestiques chez un laboureur : Nicolas Ganne l’ainé
demeurant également à Daudes. Louise sera baptisée le 9, soit le lendemain de
sa naissance, en l’église de Daudes, en présence des oncles de son père :
Claude Fleuriot, recteur d’école à Montaulin, et Louis Hennequin, compagnon
tisserand à Troyes (paroisse de Sainte-Madeleine). Notons pour la petite
histoire que ses parents s’étaient mariés à Daudes, le 16 octobre 1784. Sa
famille était originaire de la région : ses grands-parents paternels, Claudie
Hennequin et Jean Fleuriot habitaient Montreuil-sur-Barse (il était tisserand),
et ses grands-parents maternels, Catherine Rozé et Joseph Denys étaient de
Fresnoy-le-Château.
Peu après, ses parents vont habiter Lusigny, peut-être vers
1788 ( ?) et ceci pourrait expliquer la confusion de date entre le
registre de catholicité et les pièces du procès.
A une époque indéterminée [peut-être vers 1803], Louise est placée comme domestique à gages à
la ferme de Courcelles près de Clérey. Les métyayers en sont Edme Honnet et sa
femme Marie Madeleine Laplanche, native de Montiéramey. Comme elle a su plaire
à tous les habitants de Lusigny, elle plait encore à ses maîtres. Son
intelligence, ses bons services, sa beauté native, ses grâces naturelles, lui
gagnent l’affection de tous. Sa seule ambition, consiste à paraître la plus
belle et la mieux coiffée, et elle consacre la meilleure part de ses gages à un
beau toquat surmonté d’un magnifique éventail de dentelle, véritable diadème.
Le 15 février 1808, un premier incendie éclate à la
ferme ; il est maitrisé. Louise Fleuriot, pendant cet incendie, paraît ne
pas s’occuper de ce désastre, qui aurait pu devenir considérable. Dès le
lendemain, et pendant les jours qui suivent, Louise parait réfléchie, triste et
inquiète. Elle répond à M. le Maire, qui s’interroge sur la cause de ce
changement : " On a dit bien des raisons, mais, d’ici quelques jours, on
en dira bien davantage encore ! "
Mais le 22 février, à « cinq heures du soir », un
second sinistre ravage la ferme de Courcelles.
A cette époque, les incendies sont nombreux dans les campagnes. Les
toits de chaume flambent rapidement. Les accidents sont fréquents mais la
malveillance, les vengeances, sont très courantes ; nos ancêtres avaient
le « brandon » facile. Cette fois, l’élément destructeur sévit avec
fureur. Le toit de la grange s’écroule, et l’étable devient le foyer d’un autre
incendie. Tout le monde attribue cette catastrophe, à une malveillance
calculée. D’après les investigations de la justice, il résulte " que les
incendies ne sont, à n’en pas douter, que l’effet d’une vengeance ".
L’acte d’accusation fait connaître que Honnet et sa femme, depuis de longues
années fermiers de M. de Courcelles, sont très fâchés de quitter leur fermage,
où ils ont fait de bonnes affaires, et que le bail expirant le 15 avril, ne
leur serait pas renouvelé, et qu’on aurait entendu la femme Honnet dire entre
les deux incendies : " Une autre fois, on ne les manquera pas ! ".
Le feu a éclaté peu après que Louise revienne des champs avec
les moutons. On cherche un coupable, et il semble que l’on voit la trace des
sabots de Louise. Interrogée sur les causes de la déchirure de son jupon, elle
est prise en flagrant délit de mensonge, déclarant " tantôt qu’elle s’est
laissée tomber en allant avertir son maître, tantôt que c’était dans les
taillis que cette déchirure avait été faite ". Ce n’est pas là le seul
mensonge que Louise commet dans sa défense. Dans une autre déclaration à la
gendarmerie, elle dit " que Claude-Alexandre Durand avait menacé de rendre
la femme Honnet plus basse que la terre, de la réduire jusqu’à la cendre
".
Le 27 février, Louise dit que " c’est Durand qui a mis
le feu, lui montrant un sabot où il y avait du feu, qu’il resta dans la grange
et mit le feu dans la troisième potée, et qu’il força ensuite Louise, en
menaçant de la tuer, de porter deux charbons dans l’écurie aux vaches… "
Durand nie formellement toutes ces allégations, et Louise
convient que ses déclarations sont contraires à la vérité.
Dans son interrogatoire du 4 mars, Louise déclare que "
cédant aux instances et aux promesses de la femme Honnet, elle a eu la
faiblesse de porter du feu dans l’écurie aux vaches et de mettre le feu à une
poignée de paille et de foin ". Puis elle accable la femme Honnet, sa
maîtresse, qui nie ces accusations.
Les aveux de Louise, son indifférence pendant le premier
sinistre, ses propos des 7 et 22 février, son enjouement pendant le second
incendie, où elle ne donne aucun secours, qu’elle cherche au contraire à
détourner les garçons en les provoquant à s’amuser avec elle… tout enfin, fait
entrer dans l’esprit des jurés une si profonde conviction, qu’ils prononcent un
verdict de culpabilité. Elle ne peut être sauvée de l’échafaud, et l’arrêt le
20 mai surprend la foule et l’émeut profondément.
Le 22 avril 1808, le jugement désigne Louise Fleuriot dite
« La Fleuriotte » comme étant l’incendiaire et le 21 mai de la même
année 1808, elle est menée au supplice revêtue de la chemine rouge des
incendiaires (et non pas du voile noir qui était réservé aux criminels),
résignée et repentante, accompagnée de l’aumônier, elle sort de prison, pour
aller en place publique subir la peine prononcée contre elle. Le trajet du
palais des anciens comtes de Champagne au Marché-au-Blé (place J. Jaurès), est
long, devant une foule, toujours trop avide de ces sortes de spectacles. Lorsque
sa tête rasée, mais couverte de son toquat est tombée, le corps de Louise n’est
pas porté autour de l’échafaud.
Son acte de décès portera la simple mention : « trouvée
morte sur la place du marché au bled ».
Est-ce donc ainsi que l’on écrit l’histoire ? Les faits
réels sont destinés à moraliser et à instruire, le narrateur doit être fidèle
aux vrais faits qu’il rappelle !
Quelles que soient les causes de l’incendie de Courcelles,
Louise Fleuriot en est accusée. Il ne nous appartient pas de juger si la cause
était juste ou s’il s’est agi d’une erreur judiciaire.
Avec ou sans raison, les habitants de la région n’ont jamais
voulu croire à la culpabilité de la Fleuriotte. Ceci a incité Louis Ulbach
(1882-1889) à écrire son roman : « La Fleuriotte » et a inspiré
à Amédée Aufauvre une pièce de théâtre, jouée d’abord à Troyes en 1864, puis
dans de nombreux villages.
Or, n’oublions pas que le drame était encore très proche et
que de nombreux témoins étaient encore vivants. Pour éviter des procès à
l’issus incertaine, les deux écrivains ont, en partie, travesti la
vérité : ils ont mis une sorte de trame à demi transparente sur les lieux
et les noms. Ainsi Madame Honnet devint Madame Boissonnet, Louise Fleuriot, la
Fleuriotte trouvée dans la tour de l’Hôtel-Dieu de Troyes, Daudes, son pays
d’origine remplacé par Vaudes où elle n’était pas connue, etc.
C’est cet écheveau, volontairement embrouillé qui a
progressivement créé la légende de la Fleuriotte.
Malheureusement pour nous, on voulut y voir matière à
folklore. Alors, se basant sur le roman, on créa le toquat « La
Fleuriotte », « aux ailes de papillon », puis on implanta cette
coiffe à Saint-Parre-lès-Vaudes, puis de là, à Rumilly-lès-Vaudes… et ce
toquat, authentiquement faux, se répandit dans le département.
Mais que l’on cesse dont de faire du folklore ridicule, que
l’on cherche sérieusement ce qui est, au lieu d’inventer ce que l’on croit
être. L’Histoire ne s’écrit pas, elle se relate.
Le Beau
toquat
Paroles
de C. Morat
Musique
de H. Olivier
Le roman de Louis Ulbach et la pièce d’Amédée Aufauvre, qui
ont popularisé l’histoire de Louise Fleuriot, sont encore dans toutes les
mémoires.
On se souvient bien moins de la chanson que notre héroïne a
inspirée.
Puisqu’un heureux hasard nous a fait redécouvrir cette
complainte, puisqu’à l’occasion d’un numéro sur le toquat nous sommes amenés à
rappeler l’histoire de « La Fleuriotte », il nous a semblé utile de
la publier, tout en précisant bien qu’il ne s’agit pas d’un chant folklorique.
1er couplet
Le Toquat, Toca, Tocat, Toqua, Tocqua ou Toquet ?
Quelle est l’orthographie usitée ?
L’historien « archéologue de
valeur » Théophile Habert écrit en 1845 le « toqua
commun » ; pour Louis Ulbach dans son roman « La Fleuriotte »
en 1881, c’est le « beau Toquat », comme Antoine
Chalignes, auteur de la véritable histoire de Louise Fleuriot ou « Le
beau-toquat », en 1852. Pierre-Agustin-Eusèbe-Girault-De-Saint-Fargeau,
célèbre littérateur dit qu’en 1840, à Briel-sur-Barse, on dit
« toka » et à Thennelière « tocqua »…
Ce mot, à l’origine signifie simplement
« coiffe de femme du peuple ».
Ce n’est qu’après la Révolution Française qu’apparaît le « beau toquat ». Ce superlatif ne convient qu’à une coiffe qui sera nécessairement la coiffe des grandes circonstances, la coiffe de cérémonie, elle s’oppose donc au toquat commun.
La Société des
Amis des Musées de Troyes, acheta en 1960 du peintre troyen Henri
Valton (1798-1878) un intéressant tableau « Coiffes » de 1837,
peint avec une remarquable minutie et un évident souci d’exactitude. Il
représente un colporteur, revêtu de la « blaude » (vêtement des
paysans et des ouvriers) et vendant des châles à des femmes de la
région troyenne. La scène se passe sur la place d’un petit village dont on voit
l’église en arrière-plan. Les femmes sont parées de beaux costumes
traditionnels tels qu’on les portait à cette époque, et disposées
astucieusement de façon à présenter la haute coiffe de dos, de face et de
profil, les fragiles coiffes étant faites de mousseline brodée, de fine
dentelle plissée et tuyautée et de larges rubans d’ottoman, de gros-grain ou de
velours disposés de manière à former, en arrière, un grand nœud, et, en avant,
2 belles coques épanouies ou diagonales. Ce ruban, d’un ton soutenu, tranchait
heureusement sur la blancheur de la dentelle. Le fragile et gracieux
échafaudage reposait sur un rouleau de cheveux descendant assez bas sur la
nuque et savamment combiné pour lui servir de support.
Le toquat était le digne couronnement d’une toilette traditionnelle fort gracieuse et seyante : robe ample, très froncée à la taille et comportant une fente permettant d’accéder à la « pouillère », sorte de poche dissimulée sous la jupe, manches longues et étroites, corsage ajusté, presqu’entièrement recouvert d’un fichu de dentelle blanche, ou encore d’un immense châle de voile de soie brodé de « larmes du diable », tel celui qui, au Musée de Vauluisant, accompagne le toquat. Le tablier qui se posait sur la jupe pouvait être plus ou moins richement décoré. Les pieds étaient chaussés de souliers découverts, sans talons, que Valton a figuré se détachant sur des bas blancs.
ROSEROT (Alphonse) —Dictionnaire
historique de Troyes.
ROSEROT DE MELIN (Mgr Joseph) —Le
diocèse de Troyes, des origines à nos jours.
BONNARD (Mgr J. Dieudonné)-
archives personnelles
BEAUCHAMP (Louis A. Marquis de) mon
aïeul – archives familiales


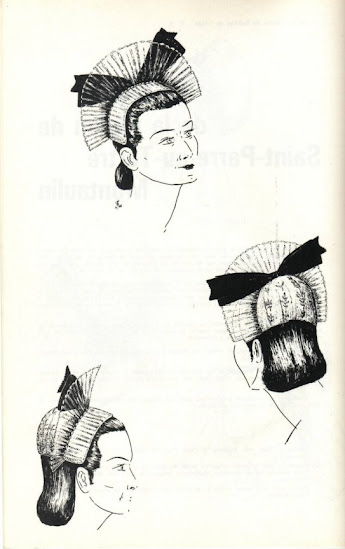









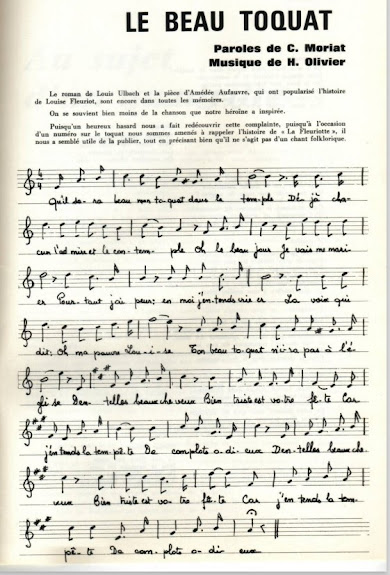









Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire