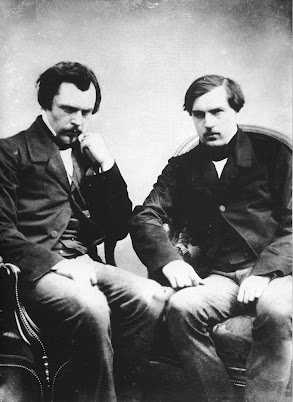Le
2ème Concile, réuni à Troyes après 429, composé de 24 évêques, décide que les Juifs ne
sortiraient pas de leurs maisons, depuis le Jeudi-Saint jusqu’au lendemain de
Pâques et n’auraient pendant ce temps, aucune communication avec les chrétiens.
Charles
II-le-Chauve se rend à Troyes pour y passer les fêtes de Pâques en 840. Le
Samedi-Saint, il se passe un fait qui est considéré comme un heureux
présage. Le roi arrive à Troyes sans bagages, et n’a avec lui que les vêtements
qu’il porte. Au moment où il sort du bain, on lui apporte tous ses vêtements,
sa couronne et autres signes royaux, dont il se pare pendant la célébration des
fêtes de Pâques. L’arrivée des bagages royaux, protégée par un petit nombre
d’hommes, qui avaient couru de grands dangers, en revenant d’Aquitaine, ranima
le courage du roi. qui met en fuite l’armée de Lothaire. Louis de
Bavière vient pour conférer avec lui.
La
ville et le bailliage de Troyes avaient au XIVe siècle des artisans qualifiés
royaux, tels que charpentiers, maçons… Comme les officiers du Roi, ils recevaient leurs
robes d’été à Pâques.
En
1374, la Cour des Grands* Jours édicte dans ses statuts qu’aucune brebis
ne peut être tuée depuis Pâques jusqu’à l’Ascension.
Le
chapitre de Saint-Pierre, depuis un temps immémorial se rend en l’église de
l’abbaye, le mardi de Pâques.
L’ouvrage
de " limes " est interdit de la Saint-Remy jusqu’à Pâques, "
après 8 h du soir, sonnées à l’horloge commune ", et de Pâques à la
Saint-Remy", après l’heure de Complies, sonnée à Saint-Urbain, et le matin
avant 4 heures.
Une
bulle de Paul V, de 1452, porte rémission pleine et entière de leurs péchés à
ceux qui visiteront dévotement l’église de Saint-Pierre, le jour de Pâques.
En
1464, les barbiers ne peuvent " saigner ni peigner
" le jour de Pâques.
En
1482, les échevins sont
élus chaque année, le mardi ou le mercredi de Pâques, par les
conseillers de ville et 64 notables.
Le
jeu de la Pelote, pratiqué le jour de Pâques dans un grand
nombre d’églises est supprimé en 1506 dans la collégiale Saint-Etienne (en 1564 à
Saint-Pierre). Le jour de Pâques " après None ", le chapitre allait
chercher l’évêque processionnellement pour chanter les Vêpres. Le cortège se
rendait dans la salle capitulaire. Le doyen apportait une balle et une toupie
« avec une tiare aux armes de l’évêque ». Le cloîtrier plaçait la
toupie sur une bancelle et 3 fois l’évêque lançait la balle sur la toupie.
Cette balle passait ensuite aux assistants qui, chacun 3 fois, jetaient la pelote
sur la toupie. Le jeu fini, l’évêque offrait du vin rouge, du vin blanc, des oublies
et des pommes. Le cloîtrier présentait le verre au doyen, buvait après lui, et
le verre lui appartenait.
Au
XVIe siècle, le jour de Pâques, à la cathédrale, on représentait à l’office de
Matines, la scène des Trois
Marie au tombeau de Jésus Christ.
Les
draps de Troyes ont un pli déterminé qui ne doit pas être imité pour la mise en
vente de draps fabriqués ailleurs. Ces statuts, en 70 articles, sont donnés à
Pâques 1510, par Louis XII, pendant son séjour à Troyes. Le roi donne aussi une ordonnance sur
l’alignement des rues.
A
Pâques 1562, Les 2 partis calvinistes et catholiques demeurent
relativement calmes. Ces derniers s’abstiennent de faire comme de
coutume, des processions fraternelles.
La
tradition d’offrir des œufs décorés teints ou travaillés est bien antérieure au
christianisme. L’œuf est sans doute le plus vieux et le plus universel symbole
de vie et de multiples rituels lui ont été associés depuis la nuit des temps.
Chez les catholiques, depuis le VIII° s., les cloches
cessent de sonner à partir du Jeudi Saint. La tradition prétend qu’elles sont
parties à Rome. Elles reviennent dans la nuit de Pâques, chargées d'œufs
multicolores qu'elles déversent dans les jardins, où les enfants vont les
découvrir.
Au
XIIIe siècle, le jour de
Pâques, à Troyes, les clercs des églises, les étudiants ainsi que les jeunes
gens des différents quartiers s’assemblent sur les places et forment un long
cortège en tête duquel on retrouve bannières, tambours et trompettes. Ils se
rendent en chœur sur le parvis de la cathédrale, où ils chantent une partie de
l’office appelée "Laudes" puis ils s’éparpillent dans les rues où ils font la quête
des oeufs de Pâques.
Plus
tard, les cloches sont remplacées par des crécelles, et les enfants de chœur
parcourent le village en les faisant tourner, et remplissant des paniers à
vendanges d’œufs, qu’ils se partagent. C’est ce que l’on
appelle les roulées. Cette coutume existe encore dans de nombreux villages
aubois.
A
cette époque, lors du carême, l'Église interdit la
consommation d'œufs pendant cette période de quarante jours. Il
s'agissait donc à l'issue du jeûne de consommer les œufs qui s'étaient
accumulés pendant le carême, en les mangeant normalement pour les plus récents et en les cuisant
puis en les décorant pour les plus vieux.
Avant
la démocratisation du chocolat, les œufs étaient naturels et décorés par les
enfants. À l'œuf est associée la poule, qu'on trouve maintenant sous forme de
statuette en chocolat. Les confiseries ne sont maintenant plus limitées, à la
forme de l'œuf mais peuvent être de véritables sculptures de chocolat et de
sucre et représentent parfois des personnages ou des objets qui n'ont aucun
lien avec le modèle d'origine.
La "chasse aux
œufs " est une tradition ancienne. A Troyes, c’est dans les petits jardins que
cela se produisait, de même que dans la plupart des villages
aubois ! Il faut découvrir le maximum d'œufs avant une heure donnée.
FABERGÉ
Les œufs impériaux
La célèbre série de 50 œufs de Pâques impériaux a
été créée pour la famille impériale russe de 1885 à 1916, lorsque l'entreprise
était dirigée par Peter Carl Fabergé. Ces créations sont inextricablement liées
à la gloire et au destin tragique de la dernière famille Romanov. Elles
constituent l'ultime réalisation de la célèbre maison de joaillerie russe et
doivent également être considérées comme les dernières grandes commandes
d'objets d'art. Dix œufs ont été produits de 1885 à 1893, sous le règne de
l'empereur Alexandre III ; 40 autres furent créés sous le règne de son fils
dévoué, Nicolas II, deux chaque année, un pour sa mère, la douairière, le
second pour son épouse.
La série a commencé en 1885 lorsque l'empereur
Alexandre III, par l'intermédiaire de son oncle, le grand-duc Vladimir,
commanda à Fabergé un œuf de Pâques comme cadeau de Pâques pour son épouse,
l'impératrice Maria Feodorovna. Initialement prévue par Fabergé pour contenir
une bague en diamant, la version finale, suivant les instructions spécifiques
de l'Empereur, comprenait un pendentif en rubis de grande valeur. Après la
première commande, Fabergé fut nommé « orfèvre spécialement nommé à la couronne
impériale », et la légende se poursuivit au cours des 31 années suivantes.
Selon la tradition de la famille Fabergé, l'entreprise disposait d'une totale
liberté pour les futurs œufs de Pâques impériaux. Même l’Empereur ne savait pas
quelle forme ils prendraient. La seule condition était que chacun contienne une
surprise.
L'œuf de poule, 1885
Inspiré d'un original du XVIIIe siècle, l'œuf de
poule possède une « coquille » extérieure émaillée blanc opaque, qui s'ouvre
par torsion pour révéler une première surprise : un jaune d'or jaune mat.
Celui-ci contient à son tour une poule en or ciselé émaillée qui contenait
autrefois une réplique de la couronne impériale avec un précieux œuf pendentif
en rubis à l'intérieur. La goutte à elle seule a coûté plus de la moitié du
prix total de l’œuf (les deux étant perdus, n’étant connus que par une vieille
photographie).
Œuf de couronnement, 1897
Cet œuf, peut-être le plus emblématique de Fabergé,
a été offert par l'empereur Nicolas II à son épouse, l'impératrice Alexandra
Feodorovna, en souvenir de son entrée à Moscou le 26 mai, jour de leur couronnement
dans la cathédrale Ouspenski. Sa coque extérieure est en or multicolore,
agrémentée d'émail guilloché jaune translucide et d'aigles à deux têtes en
émail noir sertis de diamants, un motif rappelant la lourde robe en Drap d'Or
qu'elle portait lors de la cérémonie. Le monogramme bijou de l’impératrice
apparaît au sommet de l’œuf sous un diamant portrait, avec la date à la base.
L'œuf s'ouvre pour révéler une surprise sous la forme d'une réplique miniature
en or émaillé sertie de diamants du carrosse original du XVIIIe siècle de
Buckendahl qui contenait autrefois une goutte d'émeraude, remplacée plus tard
par un diamant briolette jaune (tous deux perdus). Il a fallu 13 mois à
l'artisan Georg Stein pour réaliser l'autocar de 9,4 cm (3 11/16 po).

C'est
quoi Pâques pour les chrétiens ?
Le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la
Résurrection de Jésus. La fête de Pâques survient juste après la Semaine
sainte, qui s’achève par la mort de Jésus et sa mise au tombeau.
« Nous vous
annonçons la Bonne nouvelle : la promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie
en notre faveur à nous, leurs enfants : il a ressuscité Jésus » (Ac 13, 32-33)
Pour les chrétiens, la Résurrection de Jésus est la
vérité culminante de leur foi dans le Christ. Elle symbolise la victoire de la
vie sur la mort et l’entrée, pour tout chrétien, dans une nouvelle ère. Les
catholiques la célèbrent lors d’une messe. La recherche des œufs de Pâques en
chocolat relève, elle, d’une tradition folklorique culturelle.
Quelle est la différence entre Pâque et Pâques
?
« Pâques » vient de l’hébreu pesah, signifiant «
passage », et qui a été traduit en grec (paskha) et en latin (pascha).
La Pâque
juive (au singulier) commémore le passage du peuple hébreu à travers la mer,
alors qu’il est poursuivi par l’armée de Pharaon. Selon le père Yves Combeau,
dans l’imaginaire biblique, la mer symbolise la mort. La Passion, la mort et la
résurrection de Jésus se déroulent pendant la fête juive. Il fait alors son
propre passage, de la mort vers la vie.
L’ajout d’un « s » à la fin de Pâques sert donc à
différencier la Pâque juive de celle chrétienne. Cette différence permet aussi
d’évoquer les différents moments commémorés, dans le christianisme, à ce moment
de l’année : la Cène, la Passion, la mort du Christ puis sa Résurrection.
Que
signifie le mot "Pâques" ?
Aux origines de Pâques
Récit de la Résurrection du Christ
Trois jours après la mort de Jésus, des femmes puis
quelques disciples se rendent au tombeau pour « achever d’embaumer le corps de
Jésus » (Mc 16, 1; Lc 24, 1). En effet, celui-ci avait été déposé rapidement
dans un linceul le vendredi soir, car le sabbat juif commençait et on ne
pouvait plus travailler ni s’occuper des morts (Jn 19, 31-42). Mais ils voient
que quelqu’un a roulé la lourde pierre : le tombeau est vide.
Ses amis, les Apôtres et Marie, sa mère, tous
ensemble font éclater leur joie dans Jérusalem : « Jésus le crucifié, Dieu l’a
ressuscité, il est vivant. » (Mt 28, 1-10).
Ces témoins courent chercher Pierre et Jean qui
constatent eux aussi que le tombeau est vide (Jn 20, 1-10). Jean, dans son
Évangile, note qu’ils trouvent posé à terre dans le tombeau les linges qui
couvraient le corps. Pour Jean, c’est à la fois un indice et un signe. En
effet, si on avait volé le corps, on aurait pris les linges qui recouvraient le
cadavre, donc ce n’est pas un vol. Ensuite, les linges de la mort sont restés
dans le tombeau, mais lui, Jésus n’est pas là. Alors Jean comprend que ce que
Jésus avait annoncé ; « il vit et il crut » (Jn 20, 8) : Jésus est vainqueur de
la mort.
Le
témoignage des apôtres
Saint Paul (1Co 15) raconte que la Résurrection
n’est pas juste une sorte de croyance, mais qu’elle a bel et bien eu lieu
devant témoins. La foi de la première communauté de croyants est fondée sur le
témoignage d’hommes et de femmes, connus des chrétiens et, pour la plupart,
vivant encore parmi eux.
Parmi ces « témoins de la Résurrection du Christ »,
Marie-Madeleine est la première à qui Jésus est apparu, devant le tombeau vide.
Apparaissant également aux apôtres, Paul précise qu’en réalité plus de 500
personnes auraient vu Jésus. Par exemple, deux disciples partant vers Emmaüs le
reconnaissent pendant leur repas, à la fraction du pain (Lc 24, 13-35).
Comment reconnaissent-ils que c'est bien lui ? Jésus
les mène surtout à constater que son corps ressuscité est celui qui a été
martyrisé et crucifié, il porte encore les traces de la Passion du Christ (Lc
24, 40 ; Jn 20).
Les
tablettes de la foi – La résurrection
Diffuser la Bonne nouvelle
Ces journées pascales engagent chacun des apôtres,
et Pierre particulièrement, dans la construction d’une ère nouvelle. Comme
témoins du Ressuscité ils demeurent les pierres de fondation de son Église. La
Résurrection accomplit l’adoption filiale car les hommes deviennent frères du
Christ, par don de la grâce. Cette filiation adoptive procure une participation
réelle de l’homme à la vie du Christ, comme Jésus appelle ses disciples après
sa Résurrection : « Allez annoncer à mes frères » (Mt 28-10, Jean 20-17).
Le
mystère pascal
Pâques est au cœur de la foi chrétienne. Elle est
l’accomplissement des promesses de l’Ancien Testament (Lc 24, 26-27) et elle
confirme la divinité de Jésus. Jésus n’est pas simplement revenu à une vie
terrestre comme cela avait été le cas de Lazare (Jn 11-44). Elle est liée au
mystère de l’Incarnation du fils de Dieu.
Il y a un double aspect dans le mystère pascal : par
sa mort, Jésus libère l’homme du péché, par sa Résurrection il lui ouvre
l’accès à une nouvelle vie. Elle consiste en la victoire sur la mort du péché
(Ep 2-4, 5). Elle s’est faite par l’œuvre de Dieu le Père et par l’œuvre de
l’Esprit sur le Fils ; elle est donc l’œuvre de la Sainte Trinité. Enfin, la
Résurrection du Christ est principe et source de la Résurrection future de l’homme.
Dans l’attente de cet accomplissement, le Christ vit dans le cœur de ses
fidèles. C’est le cœur de la Foi et de l’Espérance chrétienne.
Les tablettes de la foi - Le temps pascal
Si nous connaissons bien l’avant Pâques, le Carême,
qu’en est-il de l’après Pâques, le temps Pascal ?
Ces cinquante jours n’ont apparemment pas beaucoup
d’importance dans notre temps liturgique. Autant le carême et ses quarante
jours d’austérité sont soulignés avec la couleur violette, autant le temps
Pascal semble bien pâle avec sa couleur blanche ! Et pourtant, l’Eglise,
régénérée par la Pâque du Christ, donne à ses fidèles ces cinquante jours pour
quitter le temps de la pénitence du Carême et celui de la Passion.
Le temps pascal est comme la revanche de la Vie sur
la mort. A grand renfort d’Alléluia, c’est donc le temps de la joie par
excellence.
Depuis le jour de Pâques jusqu’à la Pentecôte, les
chrétiens sont invités, à la suite du Ressuscité, à quitter leurs vêtements de
carême pour revêtir ceux de la lumière de Pâques et montrer leurs visages de
ressuscités. Le temps Pascal est donc ce temps missionnaire où tout notre être
devrait exprimer le cœur de notre foi : oui, le Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité.
Une artiste en Pologne
Œuf
peint à la main pour les Pâques Orthodoxes
La Résurrection du Christ, Geerart Seghers (Anvers 1591-1651)
en 1620
Traditionnelle iconographie du Christ ressuscité, en
soldat vainqueur de la Mort et du Mal, brandissant l’oriflamme rouge et blanche
décorée d’une croix (comme au temps des croisades).
Sans doute peint encore en Italie, juste avant le
retour de l’artiste à Anvers à l’automne 1620, Seghers s’affirmant ici dans une
spectaculaire démonstration de grande peinture baroque italo-flamande.
Armoiries b.d., non identifiées.
Huile sur toile : Hauteur : 3,24 m ; Largeur :
2,4 m
Peint pour le maître-autel de l’église des Jésuites
de Courtrai (devenu paroissiale en 1785 sous le vocable de Saint-Michel) aux
frais de Jeanne van Balberghem, veuve de Gerard van Kerckhoven, 1620 (voir le
document d’archives cité par Coekelberghs, qui ne comporte pas, il est vrai, de
nom de peintre) ; toujours en place en 1769 (cf. Descamps, comme Seghers) ;
prévu pour figurer dans les ventes des biens des Jésuites à la suppression de
la Compagnie de Jésus, en 1776, mais resté finalement en place pour des raisons
matérielles ; présenté sans succès dans une vente publique à Courtrai en 1800
(cf. Debrabandere) ; toujours en place en 1824 et 1876 (inventaires de l’église
Saint-Michel) ; vendu en 1885-1886 lors de la rénovation gothicisante de
l’église ; De Foere, marchand d’art à Bruges ; déposé dans un couvent de Bruges
où De Foere avait une fille religieuse ; acquis par le Dr Goossens (1882-1950),
médecin des religieuses de ce couvent, Bruges, 1928 ; déposé par ses
descendants à l’église Notre-Dame de Courtrai de 1984 à 1989 ; vendu par ces
derniers à la Galerie d’Arenberg (Ph. Carlier et D. Coekelberghs), Bruxelles,
1989 ; acquis de cette galerie avec le concours des Amis du Louvre, 1990.
Musée du Louvre – Paris